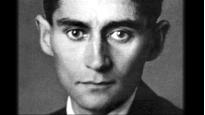Hommage à Richard Dindo

« Pour moi, en tant que réalisateur, seuls comptent le passé restitué par la mémoire, pour que jamais nous n’oubliions notre histoire ; et l’avenir, sous forme d’utopie, pour que jamais nous ne cessions de rêver d’un monde meilleur. »
Le réalisateur suisse Richard Dindo s’est éteint le 12 février à Paris. Catherine Blangonnet-Auer, directrice de la rédaction de la revue Images documentaires, revient sur l’œuvre du cinéaste.
Beaucoup de spectateurs en France ont découvert le cinéaste suisse Richard Dindo avec Dani, Michi, Renato & Max (1987, 137 min), sur une bavure policière à Zurich où quatre jeunes gens avaient trouvé la mort en 1980. Le film, sélectionné au festival Cinéma du Réel en 1988, a fortement impressionné son public autant par sa forme – une minutieuse enquête auprès des témoins sur les lieux mêmes où s’étaient déroulés les faits – que par la radicalité de son propos. Le film est entré dans les collections des bibliothèques publiques en intégrant le catalogue de la Direction du livre et de la lecture (DLL), l’ancêtre de la collection Les yeux doc, où figurait déjà Max Frisch Journal I-III (1980), un portrait de l’écrivain suisse à travers une lecture cinématographique de son récit autobiographique Montauk.
En 1988, Richard Dindo était pourtant loin d’être un inconnu. Il avait réalisé deux films très controversés en Suisse : Des Suisses dans la guerre d’Espagne (1973) et L’Exécution du traître à la patrie Ernst S. (1975). Ces films, ainsi que Dani, Michi, Renato & Max, et les polémiques qui les ont accompagnés, lui ont valu une réputation durable de « cinéaste politique ». Cette étiquette réductrice l’agaçait, bien que, ayant vécu intensément les événements de mai 68 à Paris, il soit resté fidèle aux idéaux de cette génération. Parmi les 38 films qu’il a réalisés de 1970 à 2019, un grand nombre est consacré à des figures de rebelles, de résistants, icônes ou inconnus.
Richard Dindo se définissait comme un « cinéaste du livre ». Il aimait la littérature et il a élaboré un art du portrait et de la biographie littéraire dans sept films majeurs : Arthur Rimbaud, une biographie (1991), Une saison au paradis (1996, avec Breyten Breytenbach), Genet à Chatila (1999), Aragon, le roman de Matisse (2003), Qui était Kafka (2005), Le Voyage de Bashô (2018), Une mort dans la famille (2019, d’après le roman de James Agee).
« Les écrivains que nous aimons, écrivait-il, représentent notre propre rêve du langage. Ils disent ce que nous pensons et ressentons nous-mêmes. Leur vérité est aussi la nôtre et ça passe par le langage, car il n’y a pas de vérité en dehors du langage. » Richard Dindo, « Notre rêve du langage » in Images documentaires n°109 (2023)
Pour lui, le langage était premier, l’image venait ensuite. Il effectuait une « réduction à l’essentiel » en choisissant un certain nombre de phrases de l’écrivain pour être lues en off. Puis il se mettait en quête d’images « possibles ». « Comme toujours, écrivait-il, quand on travaille sur le passé, la mémoire, l’absence, la mort, le cinéma documentaire atteint ses limites objectives. On est en face du vide, il n’y a d’abord rien à filmer. ». Cinéaste de la mémoire, de la reconstruction du passé, ses films prennent la forme d’enquêtes sur des lieux de mémoire chargés d’émotion.
Documentariste « impur », comme il aimait aussi à se définir, il cherchait sans cesse de nouvelles formes de représentation, entre documentaire et fiction. Lorsqu’il s’agissait d’évoquer des morts, il faisait appel à des acteurs et des actrices pour les incarner : « Ils sont là à la place des morts. Ils ne parlent pas. Il n’y a pas de dialogues. Ce sont des métaphores, des apparitions, des rêves. ».
Un des plus beaux films de Richard Dindo est Homo Faber (trois femmes) (2014), une approche à la fois documentaire et totalement fictionnalisée du roman de Max Frisch. Trois actrices représentant les trois personnages féminins du livre sont magnifiquement filmées dans les paysages du roman. C’est Walter Faber, le héros du livre, qui est censé les filmer et c’est sa voix intérieure que l’on entend en off. « Il s’agit d’un film assez radical et purement poétique, nous dit Richard Dindo, avec lequel je vais au cœur et au sommet de ce que j’entends par "déborder" les limites du cinéma documentaire là où on se trouve devant l’impossibilité objective de filmer simplement la réalité telle qu’elle se présente. » (www.richarddindo.ch)
En 2023, à l’occasion de la préparation d’un entretien pour un numéro d’Images documentaires sur la littérature, Richard Dindo me confiait un scénario, une biographie de Marguerite Duras, qu’il souhaitait voir interpréter par Irène Jacob ou Fanny Ardant. Il n’a pas pu monter la production de ce film, pas plus que son projet sur Edmond Jabès, qui sont restés à l’état de rêves comme, hélas, tant d’autres de ses projets.